Career / Kirsten Green
8 years ago by
Erik
Pendant des années, le monde de la finance m’a beaucoup intimidée. Les chiffres et moi, on n’avait jamais été très amis, j’aspirais plutôt à devenir écrivain, donc quand les gens se mettaient à parler de finances et de business, ça me passait complètement au-dessus de la tête…
Mais depuis presque 5 ans que je travaille au Studio, je me suis rendu compte qu’en fait, j’adore tout ce qui touche au business. Oui, j’ai été la première surprise, mais tout à coup, en voyant le Studio commencer à vraiment se développer, je me suis prise de passion pour les entrepreneurs et leur mode de financement. Et quand on travaille dans une boîte du numérique, il est impossible d’ignorer ce phénomène des start-up financées par capital-risque, investisseurs et tout genre et introductions en bourse. C’est comme ça qu’on a rencontré Kirsten.
Un jour que je lisais Fast Company, je suis tombée sur un article qui parlait de Kirsten Green, spécialiste du capital-risque qui a son propre fond, Forerunner Ventures. Kirsten a investi dans des marques retail qu’on adore comme Warby Parker et Glossier. Et en plus, dans sa boîte, il n’y a que des femmes, ce qui est assez rare dans un secteur principalement composé d’hommes blancs d’âge mur. J’étais donc ravie de pouvoir la rencontrer avec Garance à l’occasion d’une séance de dédicaces à San Francisco (où elle vit). C’est quelqu’un d’admirable, qui a bien voulu clarifier quelques concepts financiers un peu barbares…
________________
Que rêviez-vous de faire plus tard quand vous étiez petite ? Quelle a été votre première ambition ?
Je crois que la première chose qui m’a vraiment plu, c’est de construire des maisons. A l’école, il y avait un cours pendant lequel on dessinait des plans de maison. Je crois que c’était en CM1. Il fallait qu’on prévoie un budget, on dessinait les plans, et après, avec du carton, on construisait des maisons dessus. Et chaque année, il y avait un projet comme ça. On a débuté un projet intitulé Les Missions espagnoles de Californie : on devait faire des maquettes. J’aime beaucoup l’architecture, le dessin, tous les aspects techniques qu’il y a autour. Et parfois, je me dis encore que j’aimerais bien être architecte !
Vous avez grandi en Californie ? Dans la Baie ?
Oui, tout près de San Francisco.
Que faisaient vos parents ?
Mon père était avocat. Il a fait ses études à l’Air Force Academy, il a été militaire dans l’armée de l’air. Après leur mariage, mes parents ont pas mal bougé.
Ma mère est une Américaine de première génération. Elle a grandi dans un village d’Allemagne. Elle raconte que petite, en regardant les collines alentour, elle s’était toujours demandé ce qu’il y avait derrière. Du coup, à la première occasion, elle est partie. Elle a vécu dans beaucoup de pays, parle plein de langues, et a épousé mon père il y a 48 ans, à 35 ans, ce qui était considéré comme tardif à l’époque. Elle, c’est un peu l’opposé de mon père. Lui, c’est le militaire, l’avocat, la personne structurée. Elle, c’est l’électron libre. C’est fou que je sois le résultat de ces deux personnes. Elle me disait toujours : Mais tu n’as pas envie de partir quelque part ? De faire quelque chose ?
Moi, j’ai grandi dans la Baie de SF, et j’ai rencontré mon futur mari au lycée. Mes parents m’ont dit que je pouvais choisir n’importe quelle fac publique en Californie. Je ne voulais pas aller à Berkeley, c’était trop près de chez moi, donc j’ai choisi UCLA (à Los Angeles). J’adore voyager, j’adore découvrir des cultures différentes. Je serais bien partie à NY, mais mon mari ne voulait pas y aller. Je me suis mariée dès la fin de mes études, et j’ai toujours vécu ici. C’est bien différent de la vie qu’a pu avoir ma mère.
Vous avez fait des études de quoi, à UCLA ?
Economie d’entreprise.
Vous n’avez pas envisagé de faire une école de commerce ?
Mais si, j’étais persuadée que je finirais en école de commerce. C’était mon projet, à l’origine.
Mais ensuite, j’ai découvert le monde du travail et je suis quelqu’un d’entier, qui fait les choses à fond. J’étais tellement absorbée et stimulée [par mon travail] que lorsque j’ai enfin pris le temps de me demander si c’était vraiment ce que je voulais faire, j’avais déjà 31 ans. Je me suis sentie trop vieille pour faire une école de commerce, je me suis dit que j’avais raté l’occasion. J’aimais beaucoup ce que je faisais depuis 10 ans, et je ne m’étais pas vraiment interrogée sur ce que je pourrais faire d’autre.
Donc quand j’ai enfin pris le temps d’y réfléchir, j’ai pensé qu’il était un peu trop tard. J’avais un diplôme d’Economie appliquée à l’entreprise, j’avais déjà ma licence de CP [Common Public] et ma licence de CFA [Chartered Financial Analyst]. Si j’avais fait une école de commerce, ça aurait été pour avoir un réseau, mais je crois que je ne me rendais pas compte de ce que ça représentait à l’époque.
Mais si, j’étais persuadée que je finirais en école de commerce. C’était mon projet, à l’origine.
Mais ensuite, j’ai découvert le monde du travail et je suis quelqu’un d’entier, qui fait les choses à fond.
Donc après avoir fini vos études et être retournée à SF, quel a été votre premier emploi ? Qu’avez-vous fait pendant ces 10 premières années ?
J’ai été diplômée au tout début des années 90. Le marché de l’emploi américain était au plus mal, il n’y avait presque aucun recruteur sur le campus. J’avais l’impression que les seuls endroits où on pouvait trouver du travail, c’était les cabinets d’audit. C’est comme ça que j’ai fini dans ce secteur. Pourtant, je n’avais pas de diplôme de gestion-compta. J’avais juste suivi un cours ! Mais ils embauchaient et proposaient de me former. Ces entreprises prennent toute une promotion : 30 ou 40 jeunes fraîchement diplômés. Et ils proposent un programme de formation qui permet d’acquérir les connaissances pratiques. Je me suis dit que ce serait l’occasion d’obtenir mon diplôme CPA [expert-comptable] et que si je devais ensuite me lancer dans l’investissement, parce que j’avais fait un stage chez Merrill Lynch à la fac, ce serait un avantage. Donc j’ai fait de l’audit ! Franchement, qui rêve de faire de l’audit ?
Mais quand je faisais de l’audit, j’ai eu de la chance d’avoir des clients que je trouvais sympas. Les magasins comme Gymboree, The Sharper Image, Safe Way. Ça a été ma première expérience du retail.
Quand on a un diplôme de gestion-compta, en gros, il faut rester deux ans, faire valider une certaine somme d’heures d’expérience par son manager, et ensuite passer un examen. Quand on n’a pas de diplôme, il faut rester trois ans, faire plus d’heures, etc. Donc j’ai attendu trois ans et quelques semaines, et après, je suis partie.
Ensuite, je suis allée chez Donaldson-Lufkin and Jenrette, une banque d’investissement qui n’existe plus après avoir traversé pas mal de fusions. Et je crois que ça marque le début de ma carrière dans l’investissement. Donc après un bref passage chez Donaldson-Lufkin and Jenrette, je suis passée chez Montgomery Securities, où j’ai commencé à suivre le marché boursier des retailers. J’ai fait ça quelques années, puis j’ai bossé pour un groupe – au sein de la même entreprise – qui gérait des fonds. Je gérais des actifs pour des investisseurs retail, des sociétés de biens et de services.
Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce secteur ?
Franchement, c’était un choix très pragmatique
Que fait votre mari ?
Il est dans l’immobilier. Je fais juste une petite digression à son sujet, parce que ça a joué un rôle dans la façon dont je me suis développée en tant que personne. Quand on s’est rencontrés au lycée, on est sortis ensemble brièvement, et ensuite on est partis faire nos études dans des facs différentes, je suis sortie avec d’autres mecs. Moi, j’avais été élevée dans des valeurs assez strictes, je trouvais ça difficile de me plier aux attentes des autres. Lui, il a grandi dans un environnement où on lui disait : Sois toi-même. C’est très bien ! Fais ce que tu veux. Il avait donc pas mal d’assurance, du genre : Je ferai ce que j’ai envie de faire. Tiens, qu’est-ce que je pourrais faire ? Et si je ne faisais rien ?
Pendant six mois, il a travaillé pour quelqu’un, et là, il s’est dit : Ce n’est pas pour moi. Donc il a monté sa boîte, ce qui me stressait beaucoup. Je n’arrêtais pas de lui dire : Alors tu vas racheter un immeuble puis emprunter de l’argent à des gens et à des banques ? Mais on n’a pas d’argent. Tu avais du boulot, et maintenant tu n’en as plus… Ce qui m’a rendue plus agressive dans mon boulot.
Au fur et à mesure, il a fait tout ce qu’on dit qu’il ne faut pas faire. Il a embauché tous ses amis. Il a monté sa boîte il y a 18 ans, et il travaille toujours avec la même équipe. Ils s’entendent bien. Est-ce qu’ils ont changé la donne et gagné le pactole ? Pas forcément, mais ça n’était pas non plus le but au départ. Il a vraiment bâti quelque chose d’exceptionnel. Ils ont des retours sur investissement formidables. Ils n’ont jamais perdu d’argent. Plutôt l’opposé de ce qu’on aurait pu imaginer pour un électron libre qui prend des risques. Il a continué à balayer une à une toutes mes théories sur sa pseudo-irresponsabilité. Et quand j’ai enfin fait une pause, 10 ans s’étaient écoulés. C’était le moment de savoir ce que j’avais envie de faire pendant les 10 années suivantes.
Mon mari avait été un excellent exemple de ce qui peut se produire quand on s’autorise à vivre sa passion. Et pour autant, il n’était pas irresponsable. C’est un comble de se dire qu’il investit maintenant dans des immeubles d’appartements, des immeubles de plusieurs centaines d’appartement, c’est-à-dire la valeur immobilière la plus sûre, alors que je me suis lancée dans le capital-risque, les investissements les plus risqués qui soient. C’est pile l’opposé !
Comment expliqueriez-vous le capital-risque, l’investissement en termes ultra-simples ?
Il y a des marchés publics et des marchés privés. Les marchés publics ce sont les entreprises cotées en bourse. Ce sont en général des sociétés qui ont un certain degré de maturité. Avant, ce sont des entreprises avec des capitaux privés. Ce qui peut aller d’une petite épicerie de famille à une entreprise comme Square qui vient juste d’entrer en bourse. Il y a deux missions différentes. Deux raisons d’être. La petite épicerie de quartier fait vivre une famille, alors que Square propose d’offrir des solutions d’entreprise au monde entier, son fondateur veut que l’entreprise devienne globale, qu’elle gagne un marché, pour développer d’autres stratégies. Il faut pas mal de flexibilité pour se développer, évoluer, changer. Et il faut du monde, donc avec votre vision, vous devez réussir à convaincre pas mal de monde.
Si on a un un petit business familial, soit on réinvestit tout dans la boutique, soit on va voir une banque. Ces entreprises-là génèrent de l’argent qui va directement dans la poche des propriétaires (il n’est pas réinvesti). Il peut aussi arriver que ces entreprises familiales fassent appel à d’autres investisseurs, et il y a tout un réseau d’entreprises vers lesquelles se tourner pour avoir du cash-flow.
Le truc, ensuite, c’est de développer l’activité, avec la possibilité de la revendre un peu plus tard, mais il y a plusieurs façons de la financer. Ça peut être des deniers personnels, de l’argent de la banque, de l’argent qui vient de la famille et des amis, ou de l’argent provenant d’un capital-risqueur. Disons que ça, en gros, ce sont les possibilités. Le capital-risque, c’est l’option la plus agressive. Le capital-risque, c’est pour des gens qui veulent pouvoir accéder à autre chose, à un réseau, à des ressources pour innover, se démarquer. C’est pour ceux qui ont de grandes ambitions.
Ça m’a un peu gênée au départ, mais en fait, on est toujours en quête de la poule aux œufs d’or, de l’affaire qui peut valoir des milliards de dollars. Milliards c’est un peu une image, mais en gros, ce que ça veut dire, c’est qu’on cherche des grosses entreprises à forte valeur ajoutée, susceptibles d’être cotées en bourse. C’est dans ce type d’entreprises que les capital-risqueurs investissent, c’est ce qu’ils financent.
Nous on intervient dans l’investissement de départ : on rencontre les gens qui ont un business plan, on réfléchit dessus avec eux, on leur donne un peu d’argent pour poursuivre leur réflexion et commencer à faire leurs preuves, et on voit aussi des gens dont l’entreprise marche déjà bien. Peut-être avec un chiffre d’affaires de deux millions de dollars, des gens qui ont besoin d’un peu d’argent pour pouvoir embaucher une équipe, avoir un peu plus de stock, embaucher des ingénieurs pour développer un produit. Voilà les étapes où on intervient.
Le stade d’après, c’est investir un peu plus d’argent dans l’étape du business model suivante, les statistiques, avant que l’entreprise soit vraiment solide et qu’elle puisse passer à l’étape du capital-investissement. Ce sont un peu les différentes manières de procéder.
Très vite, j’ai compris que je me sentais plus proche du client. L’avènement des malls a engendré une nouvelle manière de dépenser, surtout chez les adolescents. Tout à coup, il y avait des endroits où les parents pouvaient déposer leurs enfants avec 20 dollars en poche. Et si on réfléchit bien, tous ces ados avec 20 dollars en poche, ça fait beaucoup d’argent. C’est là qu’on a commencé à échafauder des stratégies autour des ados.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à votre compte ?
C’est une décision que j’ai mûrie avec le temps. J’ai commencé chez Montgomery Securities où je m’occupais des marché des actions retail, à l’époque où la vague des malls commençait à envahir le pays.
Vous avez continué à vous occuper du retail parce que c’est avec ça que vous aviez commencé dans l’audit ?
Non. Quand je suis arrivée chez Montgomery Securities, j’ai travaillé dans le département analyse financière en charge de l’immobilier. C’était le seul poste disponible. On était en 1997, avant que le marché ne s’enflamme. On embauchait très peu, il n’y avait rien d’autre, je voulais bosser là-bas parce que c’était ce qu’il y avait de mieux sur le marché, je me disais que ce serait l’occasion de me former avec les bonnes personnes. Mais dès le moment où j’ai commencé, j’ai su que je ne voulais pas rester dans l’immobilier, et j’ai regardé autour de moi pour voir où étaient les gens avec qui j’avais des affinités.
J’ai trouvé un poste dans le groupe retail. Je venais juste de sortir de la fac, j‘avais 20 ans, j’étais bien plus jeune que la plupart de mes collègues qui avaient pas mal d’expérience alors que tout était assez nouveau pour moi. Comment est-ce que je pouvais apporter ma contribution ou faire la différence ? Très vite, j’ai compris que je me sentais plus proche du client. L’avènement des malls a engendré une nouvelle manière de dépenser, surtout chez les adolescents. Tout à coup, il y avait des endroits où les parents pouvaient déposer leurs enfants avec 20 dollars en poche. Et si on réfléchit bien, tous ces ados avec 20 dollars en poche, ça fait beaucoup d’argent. C’est là qu’on a commencé à échafauder des stratégies autour des ados.
J’allais dans les malls et je revenais voir mon équipe en disant : Le produit n’est vraiment pas terrible » ou bien « Aujourd’hui, le mall était désert. J’ai commencé à m’occuper puis à être en charge de ces secteurs ados, ça m’a beaucoup plu. Il y a eu une époque d’activité intense, donc j’allais rencontrer les entrepreneurs dont les sociétés entraient en bourse, et ensuite on a fait appel à moi pour gérer des fonds puisque j’étais en charge du marché retail. C’est comme ça que je me suis retrouvée à investir dans des entreprises du retail.
Si j’avais le nez dans le guidon, c’est parce que mon boulot me passionnait. Jusqu’à ce qu’on arrive à un cycle où il n’était plus question de croissance, tout l’investissement s’est mis à reposer sur des stratégies financières et des coupes budgétaires. Du coup, ça ne m’a plus amusée. Ce qui m’a permis de faire une pause et de me rendre compte que ce que j’aimais, c’était le côté humain de ce secteur. Je me suis dit : on est arrivés à la fin d’un cycle de retail, il y en aura forcément un autre, c’est toujours comme ça. Si je veux pouvoir agir dans le prochain cycle, il faut que je sache ce que c’est que d’investir dans des sociétés qui n’en sont qu’à leur tout premier stade de développement. Parce que le prochain cycle, c’est sûr, sera celui des entreprises en devenir.
C’est là que vous avez créé votre fond d’investissement ?
J’avais des horaires de dingue… les banques d’investissement, c’est 80 heures de boulot par semaine. Je me suis dit que si je restais, je ne me lancerais jamais, je ne voulais pas rester pour faire quelque chose de moins bien, donc je suis partie sans rien avoir d’autre.
Puis quelqu’un a été très généreux et m’a ouvert son carnet d’adresses, j’ai pu rencontrer plein de gens qui bossaient en capital-investissement. J’ai suis entrée en contact avec des gens qui m’ont proposé du travail sous forme de missions, que j’ai acceptées.
Bon, ça va sembler un peu inconscient, mais au bout de deux ans, je me suis rendu compte qu’en fait, j’avais une boîte de conseil. Il y avait cinq ou six personnes qui travaillaient avec moi sur des projets de consulting. C’était très enrichissant, mais je n’avais pas envie de faire du conseil, je voulais investir. Je me suis donc dit qu’il fallait que je fasse mes preuves. Que je montre que j’étais capable d’investir dans des entreprises en devenir. J’ai commencé à chercher des petites boîtes et j’en ai trouvé une. Je leur ai demandé s’ils avaient déjà été financés par des investisseurs. Non. J’ai proposé un million de dollars en disant qu’on pouvait bosser le projet ensemble. Et c’est comme ça que j’ai fait quelques investissements.
Je n’avais pas de fortune personnelle, donc je suis allée voir tous les gens qui bossaient chez Montgomery pour leur parler de cette ligne de soins pour la peau spéciale femmes enceintes que je pensais être en mesure de développer grâce à Internet. J’étais très intéressée par tout ce qui touchait à Internet, Facebook n’existait pas encore. Je me disais que je pourrais faire de la pub pour cette ligne de soins sur les sites en rapport avec la grossesse. Je suis allée voir tous ceux avec qui j’avais bossé. Ils ont tous été assez surpris par le choix de cette ligne de produits, mais je n’ai pas lâché le morceau. A coup de chèques de 20 000 dollars, j’ai réussi à ressembler un millions de dollars. J’avoue, ce n’est pas très glamour. Et j’ai procédé de la même façon pour sept investissements, en rassemblant 20 millions de dollars. Comme je ne connaissais pas de gens riches, c’était un peu dingue parce que je n’arrêtais pas de demander de l’argent à tout le monde. Mais j’étais super motivée, sinon, je ne l’aurais pas fait.
Mais Forerunner Ventures n’est arrivé que plus tard, non ?
En 2008, j’avais déjà un joli petit portefeuille. Mais je ne voulais plus agir au coup par coup. Il me fallait un fond. C’est à ce moment-là que Bear Stearns et Lehman Brothers se sont effondrées… et je ne me voyais pas lever des fonds pour du retail en pleine crise financière. Je suis partie travailler dans une boîte de capital-investissement que j’avais déjà conseillée. J’étais enceinte et ils m’ont proposé un super poste. Je rencontrais des gens pour voir si on pouvait éventuellement travailler ensemble. En gros, c’était du réseautage et du business development.
C’est aussi à ce moment-là que je me suis intéressée aux entrepreneurs qui montaient des entreprises innovantes, différentes, notamment dans les secteurs assez spécifiques du retail. J’ai rencontré les équipes de Birchbox et Warby Parker qui étaient encore en école de commerce. Ça a été ce qui m’a donné l’impulsion pour lever un petit fond pour jouer un rôle de business angel, j’ai fait appel à quelqu’un que je connaissais depuis 20 ans et qui avais essayé de me convaincre de travailler pour lui. Il avait un énorme hedge fund.
Donc ça a été ma première expérience en la matière. J’ai rassemblé cet argent en 2010, puis je me suis dit : j’ai des idées, j’ai un point de vue, j’ai des ressources. Je sens qu’une nouvelle tendance se dessine, on est au tout début. Il ne me reste plus qu’à comprendre comment fonctionne le capital-risque. Parce que jusqu’à maintenant, j’avais surtout fait du capital-investissement, je n’étais pas familiarisée avec ce type d’investissement. J’ai saisi toute la mécanique des différents stades d’investissement, A, B, C. Comment anticiper les différentes offres de capital-risque à venir. Tout ça demande vraiment un travail collaboratif. Une fois que j’ai saisi le rôle qu’on pouvait jouer dans ce secteur, j’ai pu aller voir des investisseurs institutionnels avec un argumentaire. Au début 2012, j’ai eu mon premier fond institutionnel. Là, on achève le deuxième et on commence une levée de fond pour le troisième.
A chaque fois qu’on réfléchit à un investissement, on essaie de savoir comment on va pouvoir communiquer avec ce partenaire. Comment collaborer et travailler ensemble de façon optimale. Donc je mets l’accent sur l’humain.
Pouvez-nous nous expliquer ce qu’est un fond institutionnel ?
Un fond institutionnel, l’argent d’un gestionnaire de fonds tierce. Son job, c’est de générer un retour sur investissement avec cet argent. Nous investisseurs sont des fonds de dotation universitaires, c’est notre investisseur principal. Notre fond représente 75 millions de dollars, et la prochaine fois, on fera peut-être plus. On a quatre ou cinq investisseurs.
Quand êtes-vous vraiment devenus une entreprise ?
Ça s’est fait assez naturellement. En quittant Montgomery Securities, je ne savais pas trop ce que j’allais faire. Je me suis dit qu’il me fallait un bureau, parce que sans bureau, on n’a pas de légitimité. Donc je me suis trouvé quelque chose downtown, et puis je me suis dit qu’il me fallait un nom. Comme j’avais envie d’investir dans le retail nouvelle génération, j’ai pensé à “Forerunner” (ndlr, précurseur en anglais). Il me fallait un vrai nom, je ne pouvais pas juste être Kirsten. J’ai eu ce bureau pendant deux ans, et puis je me suis rendu compte que personne ne venait me voir. C’était toujours moi qui allais vers les autres. C’était de l’argent jeté par les fenêtres. Donc j’ai laissé tomber ce bureau. Je crois que c’est à ce moment-là que j’ai obtenu que l’investisseur me finance, là il ne s’agissait plus de petites tentatives isolées, je pouvais vendre une stratégie, un concept, je ne me parlais plus juste en mon nom. Ça y est, on commençait à me faire confiance en tant qu’investisseuse. C’est là que je me suis dit qu’il fallait que je me professionnalise.
J’ai travaillé avec une analyste dès le début. Parmi les gens avec lesquels on collabore, il y a des investisseurs multi-secteurs, et nous on se concentre sur les entreprises orientées vers le commerce. Des co-investisseurs qui bossaient avec moi m’ont dit qu’il me fallait une équipe. Sauf que je n’avais pas assez d’argent pour pouvoir les payer. Quand j’ai levé l’argent du premier fond institutionnel, j’ai touché des management fees, c’est comme ça que l’on se paie. A partir de là, je me suis dit que je pouvais embaucher des gens. Et on vient de commencer à développer une petite équipe puisque notre fond commence à prendre de l’importance.
Que font les gens de votre équipe ? De quels types de profils a-t-on besoin quand on fait du capital-risque ?
Il y a un aspect psychologique et un aspect technique. Moi, comme je viens plutôt de la finance, je voulais quelqu’un qui ait une bonne compréhension du retail pour être complémentaire. J’espérais aussi pouvoir embaucher des gens qui sont plus futés que moi. A mon âge et comme je me suis lancée un peu tard, je trouve ça super gratifiant d’embaucher quelqu’un qui s’y connaît encore mieux que moi.
Mon associée, Eurie, c’est exactement ça, elle est trop forte. Depuis longtemps, j’avais envie d’une associée… j’avais vu pas mal de gens, mais sans jamais trouver quelqu’un d’aussi passionné que moi ou qui mette autant d’énergie dans son travail. Et puis au lieu de chercher absolument à trouver un alter ego, je me suis dit que j’allais embaucher des gens. Eurie a travaillé chez Bain pendant deux ans, pour Ebay et Nordstrom. Elle avait aussi bossé pour une boîte de capital-investissement. Elle a fait une école de commerce, elle a fait partie d’une pépinière d’entrepreneurs à Wharton et elle avait monté sa propre boîte. Donc elle avait toutes les connaissances nécessaires, et c’était agréable de pouvoir travailler avec quelqu’un qui a cette expérience, cette expertise.
A part l’expérience, quelles qualités recherchez-vous chez un futur collaborateur ?
Il faut être curieux, avoir une curiosité intellectuelle. Il est aussi très important de bien communiquer avec les gens. Parce que c’est un métier où l’humain est très important. A chaque fois qu’on réfléchit à un investissement, on essaie de savoir comment on va pouvoir communiquer avec ce partenaire. Comment collaborer et travailler ensemble de façon optimale. Donc je mets l’accent sur l’humain.
Il faut aussi faire preuve de diplomatie. Avec le temps, je commence à bien connaître mon domaine, et il faut réussir à partager son expérience et ce qu’on a appris, mais sans être arrogant ou donneur de leçons. Un entrepreneur c’est un type de profil de personne bien particulier. Il faut pouvoir se dire qu’on a de meilleures idées que les autres, il faut être très optimiste et savoir beaucoup de choses. Donc comprendre la mentalité de ce type de personne et savoir comment communiquer de façon efficace avec eux, ça me semble très intéressant. Ce sont vraiment des choses vitales. Moi, je suis à l’aise avec les chiffres, j’ai toujours passé du temps à comprendre les entreprises à travers les chiffres. Dans le capital-risque, il y a plusieurs aspects. En général, les chiffres, c’est le nerf de la guerre.
Comment as-tu compris cet aspect-là, compris qu’il ne s’agissait pas que de chiffres mais qu’il y avait aussi tout un aspect humain ?
Je crois que ça me plaît. Je fais des efforts, j’apprends chaque jour. J’essaie de travailler avec des gens bien et de m’inspirer d’eux, mais de manière générale, j’adore ce que je fais, donc je n’ai pas l’impression de faire des efforts.
De combien d’entreprises s’occupe votre fond ?
Une petite quarantaine, 37 je crois.
Parfois, le matin, je regarde mon emploi du temps et je me demande même si j’aurai le temps d’aller aux toilettes.
Et vous siégez à combien de conseils d’administration ?
Trop. En ce moment, 12. Bientôt 13. Il faut savoir faire une sélection : les conseils auxquels il est important d’être, à quel moment laisser sa place à quelqu’un d’autre, ou les quitter. Moi, à la base, je n’avais pas forcément envie d’être un investisseur en capital-risque, je voulais juste investir dans les projets les plus sympas et les plus enthousiasmants. Donc ce dont j’ai envie actuellement, c’est aussi d’accompagner ces entreprises sur le long terme, même une fois qu’elles auront acquis une certaine stabilité.
Donc sur les 13 conseils auxquels je suis, il y a Dollar Shave Club, Bonobos, Serena and Lily, des boîtes valorisées à plus de 100 ou 200 millions de dollars. Rien à voir avec les boîtes où on commence avec une petite équipe, deux fondateurs et une idée. Il faut s’astreindre à une discipline, partager son temps entre les deux profils.
Une journée-type pour vous ?
Parfois, le matin, je regarde mon emploi du temps et je me demande même si j’aurai le temps d’aller aux toilettes. J’enchaîne les meetings. C’est le seul truc qui me contrarie un peu dans mon travail, le fait d’être obligée d’enchaîner les meetings, et de dire souvent non. Moi, j’ai une position centrale. L’essentiel de l’activité de certains capital-risqueurs se concentre autour des réseaux, des relations, et c’est ce qui est le plus précieux. Mais pour ça, il faut enchaîner les réunions. Je suis un peu partagée à ce sujet, parce que j’adore faire de nouvelles rencontres.
Au fond, je suis quelqu’un d’assez introverti. Pour recharger mes batteries, j’ai besoin de calme, et mes journées sont tout sauf ça. Quand je rentre chez moi, mon fils de six ans et ma petite fille de 20 mois m’attendent. Donc en gros, les moments de calme, c’est de 21 h 30 à minuit, c’est un peu dur. Je me suis remise au sport récemment, et j’essaie de faire ça le matin. Je vais à la gym, je reviens, j’emmène Rhys à l’école et j’arrive au bureau à 8 h 30. Parfois, j’ai huit réunions d’affilée, parfois dix, et parfois six. Plein de réunions, de conseils d’administration, de coups de fil, de budgets à planifier.
Comment faites-vous pour rester concentrée ?
Franchement, c’est dur. En gros j’ai deux vitesses, on ou off . Quand je suis on, je tiens toute la journée, je suis efficace, j’ai la pêche. Mais quand je suis en mode off , j’ai envie d’annuler des trucs, je n’ai pas l’esprit suffisamment affuté. Ce qui m’arrive une ou deux fois par semaine. Ce n’est pas évident. Gérer mon emploi du temps, c’est une lutte de chaque instant. J’ai une assistante depuis six mois seulement, c’était devenu ingérable. Trouver une date, un lieu pour un meeting, ça nécessite pas mal d’échanges, donc Mary me facilite beaucoup la vie. Mais ce n’est pas encore parfait. Parfois, on se dit : On n’a qu’à mettre toutes les réunions le matin, comme ça, ça laisse les après-midis pour réfléchir et avancer. Ou On n’a qu’à se libérer deux après-midis par semaine au cas où il y aurait des imprévus. C’est vraiment un casse-tête. Il y a des jours où je me dis tant pis, au moins j’adore mon boulot. Et il y a quelque chose qui me met encore mal à l’aise, que je n’ai pas encore réglé, c’est sans doute un défaut, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Parfois, il faut faire des compromis et je culpabilise, ça me ronge.
Vous avez une grosse équipe ?
On est juste cinq. Mon assistante, Eurie mon associée, puis Melissa et Nicole.
Je suis quelqu’un d’optimiste, j’aime dire oui. Quand on me demande quelque chose, j’aime pouvoir répondre par oui . Mais ironie du sort, je travaille dans un secteur où le non est roi. Parce qu’on passe notre temps à dire non.
Que des femmes ?
J’y pense pas mal en ce moment parce qu’on doit embaucher deux autres personnes. Je ne sais pas encore quel discours tenir concernant la place des femmes dans le monde de la finance et de l’entreprise. C’est un sujet important, j’essaie de développer un discours qui me correspond, j’ai envie de véhiculer quelque chose de positif et de constructif, je ne veux pas apparaître comme aigrie ou rabat-joie, ce serait contre-productif.
Ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?
Bon, ça fait un peu ringard, mais c’est un honneur pour moi d’aider les gens à réaliser leur rêve. C’est stimulant et agréable. Une des entrepreneuses m’a appelée l’autre jour, pendant Thanksgiving, alors que je prenais trois jours off dans une petite cabane de pêcheur isolée, elle voulait absolument mes tenir au courant des chiffres réalisés par sa marque pour le Black Friday. Je trouve ça très sympa. Elle était super contente. Il peut aussi y avoir un entrepreneur qui vous appelle le vendredi soir parce qu’il est contrarié, et si j’arrive à lui remonter le moral en l’écoutant, c’est gratifiant. Et puis, c’est assez génial de contribuer au succès d’une marque. Dollar Shave Club, une boîte qu’on est vraiment contents de suivre, connaît une croissance absolument dingue, ça intéresse beaucoup de monde, et nous, on a la chance de travailler sur plein de nouveaux projets et de solliciter plein de gens passionnants. C’est vraiment tout un voyage, un cheminement. J’adore l’aspect humain de mon boulot, et toute l’énergie qui s’en dégage.
Avez-vous déjà fait des investissements dont vous avez doutés ou qui se sont révélés particulièrement difficiles ? Est-ce que vous vous en êtes rendu compte tout de suite ? Et comment est-ce qu’on gère ça ?
Il faut assumer ses erreurs. On ne peut pas dire à quelqu’un : Oh, je suis désolée, je me suis trompée, en fait je ne vous aime pas et je ne crois pas en vous. A un moment donné, il faut être lucide et se dire qu’on est dans un business où on se sert de l’argent des autres pour générer plus d’argent. C’est ça, la vraie priorité, et pour ce faire, il faut que je passe du temps à cultiver nos relations et à soutenir les entrepreneurs, parce que ça fera de moi un partenaire plus désirable, j’aurai accès à de meilleurs deals, et qui dit meilleur deal dit meilleur retour sur investissement. C’est ça qu’il faut garder à l’esprit. Il ne s’agit pas de bénévolat ou de philanthropie. Oh, j’aime ces gens. Non, on travaille ensemble pour générer de l’argent. Dans le même ordre d’idées, je ne vais pas non plus passer tout mon temps sur une boîte dont j’aime beaucoup l’équipe mais qui galère et dont il n’y aura jamais qu’un minuscule retour sur investissement. Je crois que dans ces situations je m’en sors en étant sincère. Mais ça se fait en investissant dans les bonnes personnes. Ce n’est jamais agréable à entendre mais les gens peuvent comprendre. Ensuite, on travaille ensemble pour essayer de trouver une autre solution. Parfois, je dis : Je suis quelqu’un d’optimiste, j’aime dire oui. Quand on me demande quelque chose, j’aime pouvoir répondre par oui . Mais ironie du sort, je travaille dans un secteur où le non est roi. Parce qu’on passe notre temps à dire non.
Le plus gros défi dans votre travail ?
La gestion de mon temps ! Ça, et ce dont on vient juste de parler. Parfois, il faut savoir baisser les bras et passer à autre chose, être réaliste et non pas juste optimiste.
Êtes-vous très investie personnellement avec certaines de ces entreprises ?
Il n’y a pas de règle. On a par exemple investi dans Jet qui vient de lever 800 millions de dollars. Marc a déjà monté deux entreprises. C’est quelqu’un qui maîtrise son sujet, il sait ce qu’il fait. Il a d’autres investisseurs à part nous, donc il n’a pas besoin de moi. On est juste amis. On échange des idées, mais je ne considère pas ça comme du travail.
Il y a une autre boîte qui vient juste de se créer, avec un très bon instinct produit, mais qui n’a pas d’expérience en matière d’opérationnel. Donc la priorité, pour que l’investissement puisse porter ses fruits, c’était de mieux encadrer l’opérationnel. Il faut également mettre des stratégies financières en place. C’est donc un projet qu’il faut suivre attentivement, mais un projet qui est en cours de développement. Il faut en identifier les besoins, aider l’entreprise à embaucher, à recruter ses collaborateurs, à hiérarchiser les priorités. Et si on fait ça tout de suite, au bout de six mois, on a quelque chose qui fonctionne.
Il y a aussi les fois où ça ne marche pas. Dans ce cas, on fait en sorte d’avoir suivi l’entreprise de façon assez régulière pour comprendre ce qui ne marche pas avant qu’il soit trop tard et qu’il n’y ait plus d’argent. Il y a deux cas de figure où on a vraiment dû se remonter les manches, passer trois jours au bureau à essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et à mesurer la marge de manœuvre dont on disposait pour pouvoir changer les choses. Souvent, on essaie d’aider les gens à comprendre l’aspect financier de leur business, c’est là qu’on aborde tout l’aspect financier. Dans certaines boîtes, les gens ne savent pas vraiment quel est le coût effectif de leurs produits, quelle devrait être leur marge et leurs dépenses. On les aide à y voir plus clair là-dedans.
Vous avez un mentor ?
Non, je n’ai pas de mentor et c’est bien dommage. D’ailleurs, on a cherché à me présenter à des gens pour que je devienne moi aussi leur mentor. Mais en toute sincérité, j’ai appris auprès de plusieurs personnes différentes. Il n’y a pas une personne en particulier avec telle ou telle expérience qui me conseille. Il y a tout un tas de personnes avec qui j’ai développé de belles relations, et pour qui j’ai beaucoup de respect.
Je me dis que j’atteins une forme de sagesse quand j’arrive à faire une pause et à me dire : Bon j’ai fait le maximum pour que ça marche. Et je continuerai à accompagner le projet, mais je vais laisser les choses se faire toutes seules. Laisser les choses se faire, lâcher prise. La patience, c’est vraiment primordial, mais j’avoue que j’ai du mal.
Un conseil qu’on vous a donné et vers lequel vous revenez tout le temps ?
On m’a donné plein de bons conseils. Vraiment. J’aimerais qu’il y ait une chose qui soit gravée dans le marbre mais ce n’est pas le cas, il n’y a pas un conseil plus important que les autres. Parfois, quand je suis super concentrée sur un truc, j’ai du mal à le lâcher. Je me dis que j’atteins une forme de sagesse quand j’arrive à faire une pause et à me dire : Bon j’ai fait le maximum pour que ça marche. Et je continuerai à accompagner le projet, mais je vais laisser les choses se faire toutes seules. Laisser les choses se faire, lâcher prise. La patience, c’est vraiment primordial, mais j’avoue que j’ai du mal.
Vos rêves pour l’avenir ? A titre professionnel et personnel ?
Le gros avantage de ma situation actuelle, c’est que j’adore ce que je fais en ce moment. Je ne sais pas si c’est un signe de maturité ou juste une prise de conscience.
J’en suis à un stade où les choses se sont mises en place mais où tout a un énorme potentiel. C’est ça, la magie. Ce que je me souhaite pour l’avenir ? Pour tout vous dire : je veux que cette situation dure le plus possible parce que je m’y sens bien.
Vous avez quel âge ?
44 ans. Ça fait 19 ans que je suis mariée, et j’ai eu ma petite fille à 42 ans passés. Il y a quelques mois, je me suis dit j’ai envie d’un dernier enfant, mais j’ai dit non. Et c’est aussi une bonne leçon : apprécier ce qu’on a, savourer le moment présent. Ce sont mes enfants qui m’ont appris ça ! Ça fait un peu cliché, un peu ringard, mais quand on est sollicité en permanence, la seule manière de tenir et d’en profiter, c’est d’être à ce qu’on fait au moment où on le fait, et d’être vraiment là. J’essaie de poser mon téléphone et d’être présente avec mes enfants pendant cette heure et demie quotidienne, parce que ça passe très vite !
J’ai la chance d’avoir des femmes géniales dans mon équipe. Mon portefeuille est encore jeune, donc tout est encore plein de promesses. J’ai tiré des leçons du passé et d’expériences négatives. J’en suis encore au stade où je regarde tout avec des étoiles plein les yeux. J’en suis à un stade où les choses se sont mises en place mais où tout a un énorme potentiel. C’est ça, la magie. Ce que je me souhaite pour l’avenir ? Pour tout vous dire : je veux que cette situation dure le plus possible parce que je m’y sens bien.




















































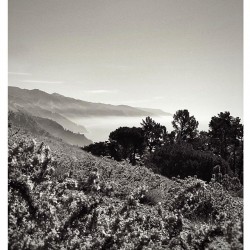






amazing and refreshingly honest. I adore that she’s real about the challenges of her job, but also the rewards for pursuing your own dreams.
i love this series! :)
http://littleaesthete.com/
Finding the money is n-1 in building a company an in making alive great ideas ..the art of knowing how and where to find the money ..is a form of art..great artist in this business can find money for any project…but if this idea or business will survive will flourish or will die depends on how good is the idea ..if the time is right for this idea..and how you go behind the idea to develop it….how much you say honest to yourself and to your first idea…
From The World With Love
Yael Guetta
http://www.ftwwl.com
This is wonderful. Having worked in business, I find too many women think they aren’t up to it, but guys never worry about not knowing enough or not being qualified, even when they are pitifully out of their leagues.
Cette interview est passionnante!
Xxx
Julie, Petite and so What?
Great interview! I really learned a great deal about a subject I usually avoid!
well, this makes me realize I am not a career-minded person whatsoever. I had no guidance from parents or goals for my work life. Was much more focused on living, and working just to support that. I feel I’m on a different planet from this woman!
p.s. I think it’s funny that all businesses now are called start-ups, when before it was just… opening a business.
Very interesting reading!
I think it’s important to know basic finance.
https://sofaundermapletree.wordpress.com
really nice interview
http://hashtagliz.com
This is such an amazing article. Thanks for sharing all of this great info! xx
http://www.fashionsensored.com
Passionnant …
Moi, la reine auto-proclamée des quiches en math et en finances(8 en math au bac L, faut le faire quand même), je commence à m’y intéresser.
http://www.cookinginjune.com/
What a great interview!
xx Kelly
Sparkles and Shoes
As a young woman who has worked in investment banking and venture capital since graduating from college and is now pursuing her MBA – THANK YOU! I genuinely love this blog but most of the career interviews make me feel like only cool, stylish women work in film or fashion or some other creative field. So this is incredibly inspiring and Kirsten is truly a rockstar in the VC world! Please interview more women in business!
Thank you so much. She’s so smart and seasoned (in the best possible meaning of this word) and a living proof that even a dream job is a job nonetheless, very hard, requiring a lot of discipline and skill. And of course it’s a tale about not giving up, and how a family has your back. You need to recharge and have other resources to lean on.
This is amazing and incredibly inspirational. Her comments on patience, and being an active part of the process while also knowing you can’t control everything and just needing to trust that things will work out – that really resonated with me. THAT might be the piece of advice that I’ll keep coming back to!
Nice post :)
______________________
PERSONAL STYLE BLOG
http://evdaily.blogspot.com
J’adore les interviews carrière, c’est long, détaillé, précis, très terre-à-terre et sans fioritures, bref on a l’impression d’avoir accès à la « vraie vie » des personnes interviewées!
Love the Career interviews.
Will you interview someone who’s in the Fashion strategy consulting, or agent for some international designer brands?
XXX
Alexandra
I didn’t read the article : it looks so long !!! I need serious time to seat back and read it. By the way, is it me or it looks like career and job take suuuuuch a big place in Americans’ life? Bbecause without job they are lost (no social security, no money, no holidays, etc.)? Maybe the new mantra « Do what you like » comes from this reality : People in America need their job to live so much that nowadays companies make everything to make them stay longer there in the office to make it more pleasand and fun. I would never say for instance in Europe « I work hard/ I play hard » or « I’m so proud that I made it ». Made-it because of my work ??? Seriously no. To me, job is not everything : first know yourself, no need to work hard to play hard. Why just work, play and overall live?
This is a great piece – I too have felt a bit intimidated by the numbers side of things. But I think it’s because business courses and the like have always done such a good job of conveying the concepts in a sterile setting. Even « case studies » are looks at the minutiae of past companies, rather than actively getting experience on your own. I’m so happy to hear you discovered your love of business by being immersed in one!
Inspiring, informative, authentic – thank you
This series is wonderful, I love the honest interviews that touch so many different careers and types of positions. Please keep more of these coming!
merci pour cette interview… Cette femme est une battante !
Great article Emily. Thanks :)
Best career interview ever! She sounds so real. Authenticity wins here!!
Amazing and inspiring interview!